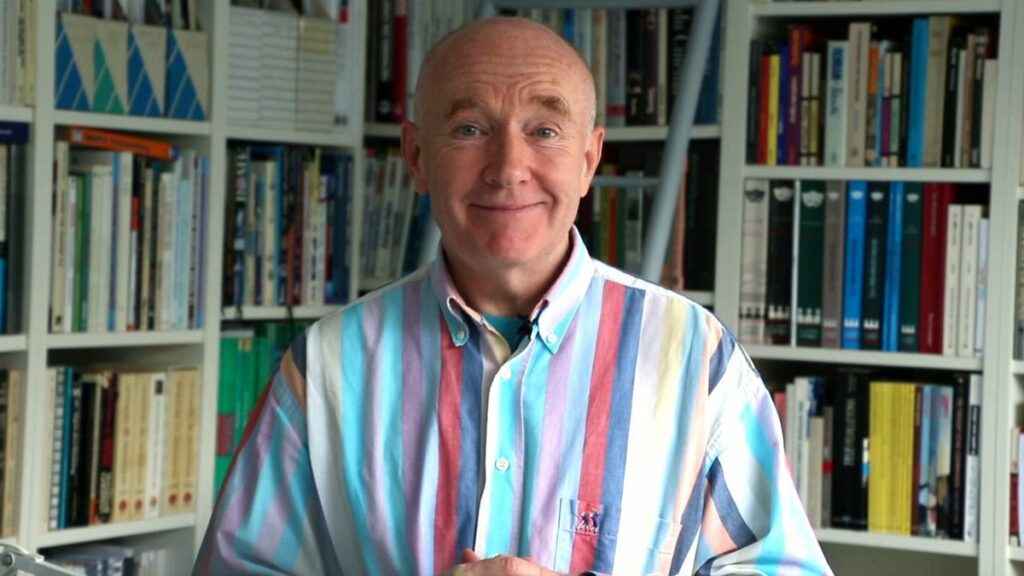
La première fois c’était en 1996 à la FNAC des Halles. Dans le rayon cinéma, au-dessus du label “scénario”, un livre épais trônait parmi d’autres plus fins. C’était La Dramaturgie d’Yves Lavandier. Au lieu de nous écraser de références et de complexité, l’ouvrage s’est avéré limpide et universel. D’Astérix à Hamlet, d’Aristote à Hitchcock, tous sont réunis par un ensemble de règles quasi-immuables. C’était comme découvrir le pouvoir des rayons X : chaque film, chaque pièce de théâtre, chaque BD, en fait chaque œuvre dramatique, apparaissait nue ou transparente. Et puis après, un sentiment d’angoisse existentiel : les mécanismes de la dramaturgie étant les mêmes depuis l’épopée de Gilgamesh, est-ce qu’on est condamnés à les répéter jusqu’à la fin des temps ? Et au détour des années 2010, par le hasard des rencontres sur Facebook, nous sommes devenus “amis” avec Yves Lavandier. L’occasion était trop belle, nous avons alors décidé d’interviewer l’auteur qui a étudié le scénario aux Etats-Unis avant d’importer les techniques de script-doctoring en France. Il en résulte ce long entretien dans lequel nous avons balayé nombre de sujets, de cette répétition anxiogène des formes, jusqu’à la place du scénariste dans l’industrie et celle des femmes dans les métiers du scénario.
Mxm : Yves Lavandier, qu’entendez-vous par « La vie est aristotélicienne » ?
Y.L. : Dans La Poétique, Aristote pose les bases de ce que doit contenir une tragédie réussie : du conflit, des enchaînements d’événements, donc des rapports de causalité, un début, un développement, une fin, des retournements, un défaut interne, etc. Quand je retrouve ces éléments dans la vie, je me dis que la vie est aristotélicienne. Dans Construire un récit, je cite une anecdote formidable, que j’ai trouvée dans un documentaire de 2017 intitulé Une enfance sous l’Occupation. Un témoin de l’époque, Roger Emmenecker, raconte que son père était instituteur en Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale et que Roger était élève dans sa classe. Son père faisait également de la résistance et utilisait le poste de radio de l’école pour écouter la BBC. Un soir, après avoir écouté Radio Londres en cachette, le père a oublié de remettre le curseur sur une fréquence autorisée. Quand un inspecteur allemand a allumé la radio le lendemain, toute la classe a entendu des voix anglaises. Gros moment de flottement. Le père de Roger s’est alors dirigé vers son fils, lui a mis une claque et lui a reproché d’avoir joué avec le poste de radio. Roger a compris la manœuvre, a confirmé qu’il était le coupable et son père n’a pas été inquiété. Il y a tout dans cette histoire vraie. Un obstacle interne, du conflit, du suspense, de l’ironie dramatique, un morceau d’activité, une chute et un protagoniste plein de ressources. Et pourtant, ce n’est pas une fiction, sortie de l’imagination d’un auteur.
Je vous en raconte une autre. C’est Tom Schulman qui la rapporte dans Oscar-winning screenwriters on screenwriting. Tom Schulman est l’auteur principal du Cercle des poètes disparus. Il reçut son Oscar du Scénario des mains de Jane Fonda. C’était en 1990, à l’époque où Jane Fonda commençait à fréquenter Ted Turner. Après avoir énoncé son discours de remerciement, Schulman est dirigé en salle de presse où l’attendent une soixantaine de journalistes, conformément au protocole. Jane Fonda, qui l’accompagne, présente Tom Schulman, récipiendaire de l’Oscar, puis demande s’il y a des questions. Et des questions, il y en a. Des tonnes de questions : « Jane, comment ça se passe avec Ted ? », « Le mariage est-il en vue ? », etc. Jane Fonda s’énerve, tance les journalistes, leur rappelle que ce n’est pas sa soirée mais celle de Schulman et invite les journalistes à poser des questions à Tom Schulman. Blanc chez les journalistes. Puis l’un d’eux pose une question à Tom Schulman : « Ça fait quel effet de recevoir un Oscar des mains de Jane ? Pensez-vous qu’elle va épouser Ted ? ». Cette histoire vraie est construite comme un gag, avec punchline final. Allez, je vous en raconte une dernière. C’est Jean Rochefort qui l’a vécue. Comme vous le savez, Rochefort était passionné d’équitation. Un jour, il participe à un concours hippique. Sur le premier obstacle, il fait tomber une barre. Pareil sur le deuxième et le troisième. Enfin, sur le quatrième obstacle, il arrive à passer sans toucher. Et là, il entend une petite voix parmi les spectateurs qui crie : « Raté ! ». Cela ferait une jolie scène de fiction. Mais c’est une histoire vraie. Vous noterez qu’un spectateur adulte avec un bon sens de l’humour aurait pu crier « Raté ! ». Cela aurait été aussi drôle. Mais cela aurait été une création, une forme de fiction. Bref, je pourrais vous raconter des milliards d’anecdotes de ce genre. L’affaire DSK, par exemple, commence par un coup de théâtre doublé d’un incident déclencheur. Ensuite on a des rebondissements, des rapports de causalité, un magnifique obstacle interne, une conclusion, un troisième acte, etc. Pour moi, tout cela est la confirmation qu’il n’y a pas de dramaturgie qu’au théâtre ou au cinéma, il y en a également dans la vie. Dès qu’un organisme vivant entreprend quelque chose (consciemment ou inconsciemment) et que le résultat est incertain, on a de la dramaturgie. Si la vie n’était pas aristotélicienne, il n’y aurait pas autant de films, de bandes dessinées, de pièces, de séries ou de romans inspirés de faits divers. De Roberto Zucco à Entrez dans la danse, du Dictateur à L’Ascension du Haut Mal, on ne compte plus les œuvres de « fiction » qui s’appuient sur la dramaturgie de la vraie vie. Sans parler des documentaires qui parfois exploitent intelligemment la narration inhérente à leur sujet pour se construire. J’en cite quelques uns dans La Dramaturgie.
Parlant d’origines et de mythologie, Jean-Claude Carrière dans son essai Raconter une histoire y consacre plusieurs chapitres, et vous juste deux mots sur La guerre des étoiles et les films de super-héros. Pourquoi si peu d’intérêt de votre part alors que certains en font des tonnes, nous disent que « c’est la nouvelle mythologie ».
Vous avez raison, certains en font des tonnes, surtout aux USA. Marc Herpoux, dans un séminaire brillant sur le genre, explique que tous les récits oscillent entre trois pôles : drame, conte et mythe. N’importe quelle histoire est un point dans ce triangle, un mélange de ces trois formes en proportions diverses. En écoutant Marc Herpoux, je me suis rendu compte que le mythe m’intéressait beaucoup moins que le drame et le conte. Le mythe traite la relation de l’humain aux dieux et au cosmos. Or je ne crois pas en Dieu. Si un récit utilise une métaphore mythologique pour me parler de l’humain, ça passe. Mais s’il pose comme postulat sous-jacent que le divin existe, je décroche vite. Notez qu’on peut raconter de formidables histoires sans y injecter le moindre milligramme de mythe. Pour reprendre le triangle de Marc Herpoux, votre récit se trouve alors sur la droite située entre la pointe drame et la pointe conte. En d’autres termes, réduire tous les récits à Vogler, Campbell et Jung serait une limitation dommageable. Les théories de Campbell sont intéressantes, elles peuvent vous stimuler, mais vous n’êtes pas obligé de vous en inspirer pour raconter une belle histoire. Je pense en vrac à Miracle en Alabama, La ruée vers l’or, Vol au-dessus d’un nid de coucou, Pas un de moins, Douze hommes en colère, Série noire, La cible humaine… Je ne vois rien de Campbell dans ces films.
Pour autant, le premier film de la série La guerre des étoiles, celui de 1977, me distrait passablement. C’est un mélange de film de guerre, de western et de science-fiction. Avec, en effet, quelques connotations spirituelles héritées de Jung. Après et avant le N°4, je m’ennuie ferme. Même en matière de créativité, je ne suis pas bluffé. D’autant que j’ai déjà vu une bonne partie des idées chez Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, dans L’Empire des mille planètes, par exemple, que George Lucas a copieusement pillé. Je trouve certains épisodes de La guerre des étoiles ridicules. Je n’arrive pas à mettre mon incrédulité en pause (la fameuse suspension of disbelief). Quand je vois dans le N°3, le futur Dark Vador se battre contre le héros sur une toute petite plaque qui bouge sur de la lave en fusion, je suis désolé, je ricane, je n’y crois pas deux minutes. Mettez-vous tout prêt d’une roche dont la température avoisine les mille degrés Celsius, vous allez voir si vous avez envie de faire le mariolle longtemps avec un sabre laser ! (rires) J’ai le même problème de crédibilité avec Le Seigneur des Anneaux. Quand Legolas, dans le deuxième, voit un lever de soleil rougeoyant et dit d’un air inspiré « Du sang a coulé, cette nuit », j’éclate de rire. Idem quand il abat quinze orques en faisant du surf sur un escalier. J’adore la trêve de l’incrédulité, je suis à fond pour, j’ai envie de la faire. Mais il y a des œuvres qui se prennent au sérieux et qui m’en demandent trop. Quand Legolas a ce dialogue mystique, il me faudrait un autre personnage qui le regarde d’un œil moqueur pour que je reste dans le film. Ou qui lui dise : « C’est juste un lever de soleil, abruti. Tu n’es pas obligé de trouver du sens partout ! ». Jusqu’à récemment, je pensais que j’aimais tous les genres, du moment que c’était bien raconté. Je me suis rendu compte que j’ai un problème avec le surnaturel quand les auteurs sont au premier degré, quand ils veulent me faire croire que les fées, les fantômes, les dimensions parallèles existent pour de bon, au lieu de les traiter comme des métaphores. En fiction, je préfère le sens figuré au sens propre.
Y aurait-il un regret dans votre question ? Vous savez qu’un auteur dont vous appréciez une partie du travail ne peut pas avoir exactement les mêmes goûts que vous. Et c’est OK. Nous ne sommes pas éloignés des grands principes de la pensée complexe. On peut s’enrichir d’un point de vue sans adhérer à son intégralité. C’est ce que je fais quand je lis un essayiste et c’est ce que j’invite mes lecteurs à faire avec mes livres. Deuxièmement, comme je le développe dans Évaluer un scénario, si vous êtes authentique et que vous aimez La guerre des étoiles, vous avez raison comme j’ai raison de m’y ennuyer. Car, croyez-moi, je suis authentique. Je me contrefiche d’avoir un panthéon politiquement correct. L’important n’est pas d’être d’accord avec son voisin mais d’être en accord avec soi-même. Tout cela pour dire que La Dramaturgie n’est pas un livre 100 % objectif. Ce n’est pas, non plus, la synthèse exhaustive de tous les traités de narration du monde. La Dramaturgie est, entre autres choses, l’œuvre d’un mécréant qui a une formation en psychologie et en sciences dures.
Je n’aime pas spécialement La guerre des étoiles, et encore moins Le Seigneur des Anneaux, mais qu’importe. Vous l’avez remarqué ou pas, dans tous les films de super-héros il y a un conflit avec le père. Est-ce dû à l’application à la lettre du schéma campbellien ?
Peut-être… Est-ce que Le Roi Lear respecte Campbell ? Et la trilogie de Pagnol ? Chinatown ? L’incompris ? Departures ? Je n’en sais rien. Dans Sonate d’automne, le conflit est gratiné mais c’est avec une mère. Est-ce que ça compte ? En fait, je m’en fous ! (rires)
Ce n’est pas grave.
Le critère, à mon avis, n’est pas que telle œuvre respecte à la lettre Aristote, Campbell, Truby, Snyder ou qui vous voudrez. Le critère c’est que cela vous touche, vous émeuve, vous distrait. On en revient à cette valeur cardinale qu’est l’authenticité. Ce qui est terrible c’est quand vous commencez à apprécier des œuvres et même à les citer en exemples, parce qu’elles respectent une formule à la lettre alors qu’elles sont ratées ou chiantes. J’ai vu une prof de scénario anglaise faire cela dans un séminaire.
Vous qui avez étudié le scénario aux États-Unis, comment expliquez-vous que beaucoup de leurs films se terminent par une bagarre ? Ils règlent leurs conflits au poing. C’est dû à un formatage des récits ou des esprits ?
C’est terrible, en effet. Je pense que c’est culturel. Le culte de la bagnole, des armes à feu et des coups de poing dans la figure. Et je me demande même si ce n’est pas en train d’empirer. J’en suis arrivé à me dire qu’il existe à Hollywood une sorte de bureau de la censure où vous devez envoyer vos scénarios avant tournage. Et s’il n’y a pas de bagarre, pas de course-poursuite en voiture, à cheval ou en vaisseau spatial, pas de duel, pas de mitraillage, pas d’armes à feu, alors votre scénario est recalé, vous n’avez pas le droit de tourner. J’ironise mais c’est à se demander si ce bureau de vérification n’existe pas. En tout cas, quelle détresse, quelle vulgarité, quel appauvrissement !
Cette obsession de la bagarre est illustrée, entre mille exemples, par l’adaptation en 2011 du Secret de la Licorne et du Trésor de Rackham-le-Rouge par Steven Moffat, Edgar Wright et Joe Cornish. Ils ont remplacé le climax si inhabituel du Trésor de Rackham-le-Rouge par un duel. Ce faisant, ils privent le diptyque de sa structure enrichie (1ère réponse dramatique négative, 2ème réponse dramatique positive) et de son message quasi philosophique : le vrai trésor n’est pas à l’autre bout du monde mais chez vous, sous vos pieds.
Autre illustration : l’adaptation cinématographique de la série Mission impossible. La série créée par Bruce Geller mettait en scène des manipulations, des déguisements, des astuces, de la créativité. Tom Cruise a remplacé tout cela par des cascades. Pa-thé-ti-que.
Plus généralement, je trouve que les protagonistes du monde entier manquent d’intelligence et de créativité. Peut-être que ce sont leurs auteurs eux-mêmes qui manquent d’astuce. Celle d’Ulysse, de Lysistrata, de Schéhérazade, du Chat Botté, de Hansel et Gretel, du Baron de Münchhausen, d’Arsène Lupin, de Columbo… Pour régler un problème, on rentre dans le tas, on adopte une stratégie de bourrin. Et je suis gentil d’appeler ça une « stratégie » ! Comparez la première saison de Prison break à la deuxième. Le jour et la nuit. Dans la première saison, Michael Scofield (Wentworth Miller) est hyper astucieux. Dans la seconde, les personnages sortent un flingue à tout bout de champ. A croire que Paul Scheuring avait tout donné dans la première saison. Bien sûr, il y a quelques exceptions, que je chéris d’autant plus qu’elles confirment la règle. J’adore les astuces que Jean-Michel Charlier prête à Blueberry ou à Barbe-Rouge pour se sortir du pétrin. J’adore que, dès le tout premier tome de ses aventures, Astérix fasse preuve de ruse et non de force. J’adore la façon dont les protagonistes de L’arnaque (Paul Newman, Robert Redford) se vengent de Lonegan (Robert Shaw). Idem dans Le limier. Mais ce sont vraiment des exceptions. Sur ce plan, les films de super-héros sont d’une affligeante médiocrité. Rendez-vous compte, nous avons affaire à des personnages qui ont tous un pouvoir spécial et tout ce qu’ils savent faire, c’est se taper sur la gueule ! Dans mon système de valeurs, mieux vaut mille fois malin que bourrin. C’est le message qu’Harold apprend à tout son village dans Dragons. Vous voyez qui est Neill Blomkamp ?
Oui, le cinéaste sud-africain.
Qui a fait District 9 et un autre film très intéressant…
Elysium.
Voilà. Elysium est une jolie métaphore pour parler des ghettos de riches et des ghettos de pauvres, de l’immigration. Les pauvres sont sur Terre et veulent aller sur le satellite Elysium pour se faire soigner… C’est chouette, ça démarre super bien. Idem pour District 9 et Minority Report, d’ailleurs. La première moitié de ces trois films est formidable. Chacune d’entre elles pose des problèmes fondamentaux, des sujets d’ordre social, politique, philosophique. Et puis ça s’écroule. La deuxième moitié se termine dans une course-poursuite, pan-pan, boum-boum, vroum-vroum, avec des méchants caricaturaux. C’est triste. Certains spectateurs sont peut-être des abrutis qui aiment la bagarre mais ce n’est pas en les prenant pour ce qu’ils sont qu’on va les aider à s’élever.
Tout à fait d’accord sur la fin de ces films.
District 9, il faut le voir pour le croire. Je me souviens que c’est moitié-moitié. Une moitié où tous ces sujets importants sur l’immigré, l’étranger, sont posés. Et une seconde moitié qui est juste une course-poursuite.
D’ailleurs ça se ressent dans le style du film : il commence sur le mode faux documentaire et se termine en film d’action. Dès lors, il y aurait d’un côté le cinéma américain et de l’autre, tout le reste du monde ?
Non, pas du tout. Malheureusement, la bagarre est un principe universel et intemporel. Il suffit d’ouvrir le journal. Ou de voir le début de Borsalino. Capella (Jean-Paul Belmondo) et Siffredi (Alain Delon) font connaissance et se disputent une femme (Catherine Rouvel) à coups de poing. Ils en échangent au moins une vingtaine. Et leurs métacarpes sont intacts à la fin ! C’est à la fois triste et risible. Nous parlions là de certains films américains, pas de tous. J’apprécie Little Miss Sunshine. J’adore Monsieur Schmidt. Douze hommes en colère, Miracle en Alabama de William Gibson, adaptée par Arthur Penn. Vous allez me dire que c’est vieux.
Non !
Monsieur Schmidt est plus récent (2002). Ou Frozen River (2008). Ou Transamerica (2005). Ou Whiplash. J’ai beaucoup aimé Room en 2015. Il y a un énorme climax médian et la deuxième moitié est aussi formidable que la première, avec un joli conflit inhabituel. Le cinéma américain produit de tout. Il produit même un cinéma d’auteur, parfois jusqu’à l’excès, jusqu’à la posture artistique. Il produit des films confidentiels, des films difficiles et tout cela dans un système totalement capitaliste, non subventionné. Et puis il y a les séries : Sur écoute, Les Soprano, Breaking Bad, ce sont des œuvres d’art et c’est américain. On ne peut pas se désoler de tout le cinéma américain comme on ne peut pas se désoler de tout le cinéma français.
Mais ce qui est terrible, à propos de cette culture de bas étage, c’est qu’elle pervertit le cinéma mondial, y compris le nôtre. En 2019, est sorti un film français qui commence joliment, sur le ton de la comédie sociale, et puis soudain tout le monde se met à sortir un flingue, à se braquer, et ça finit en pétarade. Quelle détresse !
Je ne sais pas si vous avez vu Lupin sur Netflix, mais la première réflexion qui m’est venue à l’esprit c’est que c’est raconté « à l’américaine » – d’où peut-être une des raisons de son succès à l’international. Est-ce qu’il y a une manière spécifique de raconter une histoire qui serait propre aux Américains malgré tout ce qu’ils doivent au vieux continent et à Aristote ?
Je ne pense pas. Et comme je ne suis pas abonné à Netflix, je ne peux pas vous dire ce que Lupin a d’américain. Mais quand je vois Le bureau des légendes ou les quatre premières saisons d’Un village français, je vois des mécanismes que j’apprécie dans les meilleures séries américaines. J’ai adoré Mustang en 2015. Il y a un protagoniste clair (les cinq sœurs, avec la benjamine comme leader), un incident déclencheur clair (les filles se sont innocemment frottées à des garçons), un objectif clair (échapper à l’enfermement patriarcal) et beaucoup d’obstacles. Il y a en outre un magnifique crescendo : plus on avance, plus la vis se resserre. Ajoutez à tout cela du sens et un soupçon d’humour. Mustang est un film français. Avons-nous affaire à une écriture à l’américaine ? Un autre exemple : No man’s land (2001). Formidable. Ecriture à l’américaine ? D’un autre côté, j’ai aussi apprécié Room ou Monsieur Schmidt. Diriez-vous que ces films sont écrits à l’américaine ? Si oui, alors vive l’écriture à l’américaine ?
Quand je parle de scénario à l’américaine, je parle en fait de récit en tension permanente, là où les Français se permettent de laisser un peu vivre leurs personnages. Mais vous avez raison de ne pas généraliser.
C’est assez bien vu. Les Américains ont tendance à préférer les tranches de gâteau aux tranches de vie, pour reprendre une métaphore chère à Alfred Hitchcock. Je leur donne raison. A condition que cela ne mène pas obligatoirement vers le spectaculaire, les cascades, les effets spéciaux. On peut faire une tranche de gâteau avec un sujet simple, contemporain, prosaïque. Regardez ce petit film espagnol remarquable qu’est Ne dis rien (2003). L’histoire d’une femme victime de violence conjugale. Le thème est lourd, on peut craindre le pensum. Or c’est écrit comme un thriller. On est dans ce que vous appelez très justement une « tension permanente ». Quand j’ai montré Oui, mais… en Chine, une prof de cinéma de l’université de Shanghai m’a dit que mon film n’était pas écrit comme un film français mais plutôt comme un film américain. Je lui ai sauté dessus et l’ai serrée dans mes bras. Peut-être qu’elle avait tort. Peut-être que je n’ai pas compris ce qu’elle voulait dire. Toujours est-il que j’ai pris son commentaire comme un compliment et qu’elle a eu droit à un câlin. Elle a dû se dire : « Ah, ces Français ! Incorrigibles ! Même quand ils écrivent à l’américaine ».
L’adultère, c’est la poursuite en voitures du cinéma français ?
(Rires) C’est une jolie idée, c’est possible. Le triangle amoureux peut-être… Pertinente remarque. Comme je pense que les poursuites en voitures, les mitraillages et les bagarres sont culturelles dans le cinéma américain, pourquoi le triangle amoureux ne serait-il pas culturel ? A cela s’ajoute peut-être un phénomène dans le cinéma français, à savoir que les auteurs qui n’ont pas d’imagination ou de créativité parlent d’eux-mêmes. Et comme ils ont des problèmes sentimentaux, ils parlent de problèmes sentimentaux. Cela dit, le triangle amoureux et, plus généralement, les amours contrariées, me paraissent très universels, ni français, ni américain. Voyez ce magnifique film iranien qu’est Au travers des oliviers. Ou le film chinois The road home. Hyper émouvant.
Le monde entier envie notre cinéma…
Mmm…
Ou le monde a une image un peu dorée de notre cinéma ?
Je pense qu’ils sont loin de tout voir. C’est comme nous qui ne voyons que la crème du cinéma américain, qu’il soit d’auteur ou hollywoodien. Je ne suis pas sûr que le monde entier nous envie. De temps en temps, il y a quand même des auteurs anglo-saxons qui trouvent que notre cinéma pourrait être plus créatif. Dans La fugue (1975), la femme du protagoniste (Gene Hackman) lui propose d’aller voir un film réalisé par Eric Rohmer. Et le protagoniste répond qu’il a déjà vu un Rohmer et que c’était comme regarder de la peinture sécher. Sic !
« Je pense que notre regard sur le cinéma strictement contemporain est faussé. Nous manquons de recul, autant sur ce qu’on aime que sur ce qu’on déteste. »
Quels sont les films français qui trouvent grâce à vos yeux ?
Il y en a, figurez-vous. Je vous ai cité Mustang (2015). Pour rester au XXIème siècle, je pense en vrac à Après vous… (2003), Sur mes lèvres (2001), Les émotifs anonymes (2010), André le magnifique (2000), La vie d’artiste (2007), Joyeux Noël (2005), De rouille et d’os (2012), A la folie, pas du tout (2002), Chocolat (2016), Je ne suis pas là pour être aimé (2005), Ceci est mon corps (2014)… Tout n’y est pas forcément réussi mais j’y trouve mon compte. J’ai bien aimé Nous trois ou rien (2015), même si le film pourrait finir dix minutes plus tôt ou dix minutes plus tard parce qu’il n’y a pas vraiment de climax annoncé. Structurellement, ce n’est donc pas exemplaire mais la première partie, qui se déroule en Iran, est très conflictuelle et très drôle. C’est presque un mélange de torture et d’éclats de rire, c’est fascinant. J’ai adoré un film écrit et réalisé par Emmanuel Mouret en 2009 qui s’appelle Fais-moi plaisir. C’est drôle, avec des personnages caractérisés, de très belles situations, des gags incroyables. J’ai bien ri également devant Le sens de la fête (2017). Un clown à peu près blanc (Jean-Pierre Bacri, formidable) et une ribambelle d’augustes.
Deux commentaires. Primo, je n’ai pas tout vu, loin de là. Secundo, cette liste ne prouve pas grand-chose. Si vous prenez l’année 1937, par exemple, pendant laquelle il est sorti une centaine de films français en France, combien en avez-vous retenu ? La grande illusion, écrit par Charles Spaak et Jean Renoir, formidable. Et puis quoi d’autre ? Gribouille, Désiré, Regain, Un carnet de bal, François Ier, Pépé le Moko, Drôle de drame… Une poignée est encore regardable aujourd’hui. Et encore. Drôle de drame n’est pas un modèle de structure et vaut surtout pour ses comédiens. Bref, les neuf dixièmes des films de 1937 sont passés à la trappe de l’Histoire. Je pense que notre regard sur le cinéma strictement contemporain est faussé. Nous manquons de recul, autant sur ce qu’on aime que sur ce qu’on déteste. Si vous avez détesté ou adoré, ça ne se discute pas, tant que c’est sincère. Mais tirer des conclusions parce que vous vous êtes ennuyé sur trois ou cinq films, reconnaissez que la taille de l’échantillon n’est pas très élevée scientifiquement.
Si on a oublié certains films c’est peut-être parce que la mémoire n’est pas entretenue. On va peut-être redécouvrir ces films dont vous parlez. Mais je suis d’accord avec vous, on manque de recul. Le temps doit faire son affaire. Dans La Dramaturgie, vous distinguez trois formes de comédie-moquerie dont « la moquerie dévalorisante ».
C’est exact. Pour moi, la comédie est forcément une moquerie, mais le mot « moquerie » est mal vu, il sonne péjoratif. Alors que la moquerie peut être compatissante, solidaire, et même tendre. Si vous voulez un exemple de moquerie tendre, lisez Lucien, la série BD de Frank Margerin. Je pense en particulier à Ricky chez les Ricains, que j’adore et dans lequel il y a une tendresse infinie, alors que Margerin n’arrête pas de se moquer de ses personnages, tous ses personnages. Y compris ceux qui sont à l’arrière-plan ! A la fin de l’album, les membres de la bande à Lucien rêvent. Ils rêvent au succès, à la gloire. Sauf Lucien qui dort dans les bras de Carol et qui rêve qu’il est… dans les bras de Carol. Cela donne quatre cases drôles et touchantes. Certaines comédies italiennes, aussi, mélangent moquerie féroce et moquerie tendre. A la fin des Camarades, l’un des protagonistes (Renato Salvatori) part en exil. Sa petite amie (Gabriella Giorgelli) lui demande de lui écrire. « Tu ne sais pas lire ! » répond-il. « Ça ne fait rien, écris-moi quand même ! » Il y a beaucoup d’humanité dans cet humour.
Y aurait-il une certaine tendance du cinéma français à la moquerie dévalorisante ces trente dernières années ?
Je sens de la moquerie dévalorisante dans le one-man show, qu’il soit français ou anglo-saxon. Pas chez tout le monde et pas tout le temps mais je sens qu’il y a de l’agressivité. Egalement dans les interventions humoristiques à la radio ou à la télévision. Il y en a que j’adore même s’ils peuvent être cruels : Laura Laune, Gaspard Proust, Chris Esquerre… Mais j’ai vu des one-man shows agressifs et parfois dévalorisants. Dans le cinéma lui-même je n’ai pas remarqué particulièrement.
Pour moi, c’est comme si il y avait un avant/après Louis de Funès et L’emmerdeur, voire un avant/après Francis Veber ?
Peut-être en effet que l’air du temps est plus à la dérision et au cynisme. Mais intéressez-vous à Pierre Salvadori, Bruno Podalydès ou à Emmanuel Mouret. Ce n’est pas de la comédie agressive. Pour moi, le plus gros problème en comédie, ce sont les clins d’œil. Ces auteurs ou ces comédiens qui en font des tonnes et qui n’arrêtent pas de nous dire « Vous avez vu comme on est drôles ». Cela peut être dans l’écriture ou dans le jeu. Personnellement, je trouve cela vulgaire. C’est à la fois racoleur et incrédible. Un bon clown ne peut avoir aucun recul sur son potentiel comique. On trouve le même travers en bande dessinée. L’une des particularités de la bande dessinée, contrairement au cinéma, est de permettre au lecteur de s’arrêter dix minutes sur une case s’il en a envie. Ou si le dialogue est copieux. Je vois des auteurs de bande dessinée qui profite de ce pouvoir de la BD de s’arrêter aussi longtemps qu’on le veut. Alors, en pleine scène d’action, ils font envoyer des vannes par certains de leurs personnages. Et ce n’est absolument pas crédible. Quand vous avez le feu au cul, que vous devez sauver votre peau, vous ne faites pas le malin, vous ne balancez pas de bons mots. Notez que ce n’est pas une tendance récente. Henri Vernes le fait dans les albums de Bob Morane. Une partie du cinéma français a le même tic. Au début d’une grosse comédie française de 2015 que je ne citerai pas, un méchant impressionnant nous est présenté. Tout le monde comprend que si on bouge le petit doigt, on se fait décapiter. Donc, personne ne moufte. Puis le méchant se met à expliquer quelque chose à une foule mais il commet une faute de français. Devinez ce que fait l’un des plébéiens ? Il ne trouve rien de plus intelligent à faire que de souligner la faute, de mettre le nez du méchant dans sa merde. Aussitôt, bien sûr, la tête du petit rigolo roule sur les pavés. Comment peut-on être aussi con ? Ce n’est pas vraisemblable deux secondes. Même les abrutis ont l’instinct de survie. Pour que ce fût vraisemblable, il aurait d’abord fallu que le petit rigolo fût caractérisé et présenté comme une grande gueule qui ne peut pas s’empêcher de l’ouvrir. Avec, de préférence, un personnage de contradicteur raisonnable. Au lieu de cela, les auteurs font les malins et créent des personnages de malins. Or la meilleure comédie du monde, qu’elle soit exigeante, dévalorisante ou compatissante, est une comédie qui est et qui reste au premier degré. C’est nous qui rions dans la salle, ce ne sont pas les personnages et pas l’auteur non plus. On doit être au premier degré, le personnage doit être dans la merde et avoir zéro recul sur ce qu’il est en train de dire ou faire. Une partie de la comédie française tombe dans ce travers depuis quelque temps. Je le vois aussi au théâtre. Tel metteur en scène monte Le révizor et pousse les acteurs à en faire des tonnes (« Lâche-toi, coco ! On fait de la comédie, que diable ! ») alors qu’ils devraient laisser les situations conçues par Nicolas Gogol faire tout le travail. L’une des grandes forces des Monty Python et de la troupe du Splendid était de jouer des situations énormes, absurdes, au strict premier degré.
Tout à l’heure, nous opposions cinéma français et cinéma américain. Je crois sain de dépasser ces généralités. Vous avez remarqué que je cherche mes sources d’inspiration dans tous les domaines et toutes les nationalités. Je me fiche qu’une œuvre que je cite soit américaine, suédoise ou française, que ce soit une série télé ou un film. Pour certains cinéphiles purs et durs, la série télé n’est pas noble. C’est l’une des idéologies culturelles qui courent dans le cinéma français. J’ai ainsi des amis cinéphiles qui se refusent à regarder la moindre série télé. Ils se privent connement de chefs d’œuvre. Je me souviens d’un copain dramaturge français qui me disait : « Il est bien ton bouquin mais quand même tu exagères, mettre Astérix au même niveau qu’Hamlet ». Mais au contraire ! Nous avons affaire à deux œuvres géniales, chacune dans leur style. Pour moi il n’y a pas de hiérarchie, tant que l’artisanat est brillant et instructif. J’établis une hiérarchie entre un bon album d’Astérix et un mauvais, pas entre Astérix et Hamlet.
Remarquez que ce n’est pas l’avis de notre ministre de la culture (ou prétendue telle), qui a déclaré le 9 juin 2021 : « On peut entrer dans la culture par le divertissement. Par exemple, la bande dessinée permet d’entrer dans la culture. On peut arriver à lire Kundera en commençant par lire des Astérix. » Merde alors, j’en suis toujours à Astérix ! J’espère quand même atteindre Kundera avant de mourir. Cette sortie indigne me fait penser aux propos de Charles Perrault, au début de Peau d’âne : « Il est des gens, de qui l’esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n’approuve et n’estime que le pompeux et le sublime. Pour moi, j’ose poser en fait, qu’en de certains moments l’esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu’aux marionnettes. » Notez que ce commentaire de Perrault fonctionne avec « neuneu » à la place de « guindé ».
La politique des auteurs, pour vous, c’est une escroquerie ?
Le mot est un peu fort. La politique des auteurs a raison d’affirmer (depuis Ricciotto Canudo et les années 20) que le cinéma est un art et qu’en tant que tel, il doit véhiculer une vision artistique, un « regard », comme on nous l’assène ces derniers temps. Mais, à mon avis, elle fait deux erreurs : 1- croire qu’une vision artistique bien spécifique ne peut être conçue que par une seule personne, 2- croire que l’artiste principal d’un film est son réalisateur. Primo, le cinéma est un art de collaboration et il est tout à fait possible qu’une vision unique soit créée par plusieurs personnes. Sans compter qu’il y a plusieurs arts dans un film : le langage filmique, l’art du récit, l’art du comédien, la musique, la photographie, etc. Donc, logiquement, plusieurs visions artistiques. Secundo, le principal auteur d’un film qui raconte une histoire est son scénariste. Coup de bol pour les tenants de la politique des auteurs, la plupart des réalisateurs qu’ils admirent sont aussi les scénaristes ou co-scénaristes des films qu’ils ont réalisés. Mais, malheureusement pour eux et pour nous, cela entretient la confusion sur l’identité de l’auteur principal. Quand François Truffaut, dans un article célèbre de 1954 (« Une certaine tendance du cinéma français »), défend Pagnol, Cocteau, Ophüls, Tati, Renoir, Guitry, Becker, Melville, etc., défend-il des réalisateurs ou des scénaristes ? Il se trouve que les cinéastes chéris par Truffaut étaient aussi les principaux scénaristes de leurs films. Notez que ce que je dis est vrai en France. Beaucoup moins aux États-Unis. Mais les tenants de la politique des auteurs ne sont pas à une contradiction près. Devinez qui on trouve dans certains dictionnaires intitulés « Dictionnaire des réalisateurs ». Laurel et Hardy, W.C. Fields, les Marx Brothers, qui sont certes des auteurs majeurs du cinéma mais qui n’ont jamais réalisé un seul film. Bel aveu, n’est-ce pas ?
Il faut lire le texte de François Truffaut sur Ali-Baba et les 40 voleurs (paru en février 1955 dans le numéro 44 des Cahiers du Cinéma). Le film est une pochade commerciale, un film de commande réalisée en 1954 par Jacques Becker, avec Fernandel dans le rôle principal. Problème (pour Truffaut), Becker est l’un de ses cinéastes chéris, il le considère comme un auteur. De fait, en 1954, Becker a déjà réalisé (et surtout co-écrit) de jolis petits films personnels : Casque d’or, Edouard et Caroline, Rendez-vous de juillet, Antoine et Antoinette… Alors Truffaut, complètement aveuglé par ses dogmes, essaie de défendre Ali-Baba et les 40 voleurs. Son texte commence par : « A la première vision, Ali Baba m’a déçu, à la seconde ennuyé, à la troisième passionné et ravi. » Quelle abnégation ! Quel sens du devoir et du sacrifice ! Quand un film me déçoit ou m’ennuie, je vous garantis que je ne vais pas le revoir deux fois dans la foulée ! Après cet aveu, Truffaut part dans une défense du film à tout prix, où il confond « on » avec « je » et où tout est bon pour nous persuader qu’on a affaire à un grand film d’auteur. On dirait un religieux qui essaie de nous convaincre (et de se convaincre lui-même, probablement) que la Terre est plate.
A propos de la politique des auteurs, je vous rappelle que nos amis anglo-saxons ne l’ont jamais vraiment comprise. En 2013 (dans The Guardian), Vince Gilligan (l’auteur principal de Breaking bad) explique : « La pire chose que les Français nous ont donnée est la politique des auteurs. C’est un paquet de conneries. On ne fait pas un film tout seul, on fait encore moins une série télévisée tout seul. » En 1996, Sidney Lumet (dans son livre Making movies) raconte : « Il y a quelques années, j’étais invité à Paris pour une rétrospective de mes films à la Cinémathèque. Au dîner, après la projection, beaucoup de réalisateurs français se sont plaints du manque d’auteurs. J’ai essayé de leur expliquer aussi délicatement que possible que c’était peut-être de leur faute. A cause de cette absurde « politique des auteurs » et cette toute-puissance attribuée au réalisateur, la plupart des écrivains qui ont un peu de dignité ne peuvent qu’hésiter à s’aventurer au cinéma. » A propos de Lumet, avez-vous vu le générique de Network ? « Metro-Goldwyn-Mayer présente, Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch, Robert Duvall dans, Network, de Paddy Chayefsky, produit par Howard Gottfried, réalisé par Sidney Lumet. » Même principe sur l’affiche du film. Quand on verra ça en France !… J’ajoute que le scénariste Paddy Chayefsky était présent sur le tournage.
Ken Loach, l’un des piliers du festival de Cannes, disait en 2002 (dans le numéro 491 de Positif) : « L’écriture et la mise en scène sont deux talents distincts. (…) Il est difficile d’imaginer des situations, des dialogues, des personnages. Très peu de réalisateurs savent le faire. Une majorité de réalisateurs européens écrit ses scénarios, en particulier des cinéastes français, et cela se voit ! Beaucoup de films manquent d’épaisseur pour cette raison précise. Je crois qu’il y a une certaine vanité à ne pas vouloir partager le travail de création. Le film est toujours le fruit d’une collaboration. Je déteste l’expression « Un film de… ». (…) Il y a un nombre important de personnes qui travaillent ensemble sur un film, et nier cela est faire montre de beaucoup d’orgueil. »
On ne peut pas rêver plus bel exemple que Ken Loach. Personne ne discute le fait qu’il est un artiste, avec un univers personnel. On a même dit parfois, à juste titre, que Ken Loach est un cinéaste de gauche. Mais pourquoi ? Parce que ses mouvements de caméra sont de gauche ? Parce que sa direction d’acteurs est de gauche ? Soyons sérieux, s’il vous plaît. Ken Loach est un cinéaste engagé parce qu’il s’associe à des scénaristes, Jim Allen ou Paul Laverty, qui lui écrivent les histoires qu’il a envie de tourner, avec le sens qui lui sied. Ken Loach est de gauche parce qu’il filme des scénarios de gauche. Si vous tenez à tout prix à le qualifier de principal auteur des films qu’il a réalisés, c’est parce qu’il a choisi et orienté l’écriture de leur scénario, exactement comme Ernst Lubitsch ou Alfred Hitchcock en leur temps. Ce n’est pas la mise en scène de Ken Loach qui fait de lui un auteur majeur. De mon côté, je continue à penser que Jim Allen et Paul Laverty sont les principaux auteurs des films qu’ils ont écrits pour Ken Loach, même si c’est ce dernier qui prend toute la lumière. Pour ceux qui auraient l’intention de caricaturer ma pensée, je souligne que j’ai bien dit « principaux auteurs », pas « seuls auteurs ».
Comment expliquer qu’en 2020, on trouve encore des professionnels en place qui continuent à dire que le scénario ne s’apprend pas ?

A part respirer et digérer, toutes les activités humaines s’apprennent. La seule exception au monde serait le scénario ? Comment peut-on défendre une telle idée ? Donc, Aristote, Horace, Boileau, Archer, etc., sont des rigolos ? Dans leurs préfaces, Racine, Corneille, Molière, Shaw, Miller parlent des règles. Molière en a fait deux pièces (La critique de l’Ecole des Femmes et L’Impromptu de Versailles). Si les plus grands auteurs disent eux-mêmes qu’il y a des règles, c’est que ça s’apprend. Alors peut-être que vos professionnels ne croient pas à l’apprentissage conscient (donc à la lecture d’Aristote et les autres) mais reconnaissent au moins qu’on peut apprendre la narration de façon inconsciente. J’ai beaucoup discuté de ce sujet avec Francis Veber. Lui n’a pas appris consciemment, il n’est pas allé dans une école du scénario, même s’il a lu des ouvrages sur le sujet et même s’il réfléchit lui-même à cette question comme beaucoup d’auteurs. Il travaille de façon intuitive, il n’a pas véritablement de méthode. Il se bat pendant un an avec son projet. Avec son exigence aussi. Et puis surtout avec sa connaissance inconsciente des règles. Donc pourquoi pas. Parfois ça marche. Mais quand vous faites un pari sur votre génie et votre connaissance inconsciente des règles, vous prenez un putain de risque. Pardon my French.
Je pense que, dans tout débat, devant tout argument, on devrait se poser une question fondamentale : à qui profite le crime ? Je me la pose ici. En d’autres termes, quelles sont les motivations profondes, inconscientes, des professionnels qui affirment que le scénario ne s’apprend pas ? Est-ce parce que cela valorise leur génie inné ? Sur l’air de « Ça ne s’apprend pas mais moi, bien sûr, contrairement à d’autres, j’ai la grâce » ? Est-ce parce qu’ils ont la flemme d’apprendre ? Ou parce qu’ils sont allergiques à tout ce qui leur rappelle l’école ? Plein d’adultes ont été traumatisés par l’école et je peux les comprendre. Il ne faut surtout pas leur parler d’enseignement et de règles. Pour eux c’est une allergie, c’est insupportable. A fortiori s’ils embrassent une profession artistique, c’est-à-dire une profession qui n’est pas aussi rigoureuse que le droit, l’ébénisterie ou l’ingénieurie. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard s’ils exercent une profession artistique. L’art, c’est la liberté. Croit-on… A mon avis, plus on est en prison dans sa tête et plus on parle de liberté. Mais bon, j’imagine volontiers que vos professionnels sont dans une forme de rationalisation de leur ressenti.
Ils vont se raréfier avec les années.
La plupart des artistes de cinéma ont compris que le récit est un art. Le cinéma est un art mais le récit aussi est un art. Et il y a des règles, pas des recettes. McKee les appelle des « principes », Machin-Chose les appelle des guides, je n’ai pas peur du mot « règle ». La résistance, aujourd’hui, n’est pas de dire : « Il n’y a pas de règles, ça ne s’apprend pas » mais de dire : « Oui, OK, il y a des règles, admettons, mais ça conduit au formatage ». C’est le grand discours de la rébellion actuelle.
« Nous devons inspirer les filles, leur montrer qu’elles peuvent y arriver autant que les garçons. »
On en est où dans la représentation des femmes dans les métiers du scénario ?
Il y a clairement un patriarcat généralisé dont les scénaristes femmes sont victimes, tout comme les personnages de fiction féminins. Il y a aussi très peu de femmes chez les chefs cuisiniers, chez les peintres, partout dans l’art, dans beaucoup de postes. C’est formidable que ce soit en train de changer mais cela prend du temps. Dans le scénario, une femme qui m’a bluffé récemment se nomme Sally Wainwright. C’est la créatrice de la série Happy Valley. Je pense aussi à quelques romancières qui exercent dans le genre fantastique. Comme Diana Gabaldon, l’autrice de Outlander. Ou Cressida Cowell, l’autrice de Harold et les dragons. En bande dessinée, on voit aussi de plus en plus de scénaristes femmes et de dessinatrices. Même si on est encore loin de la parité. Mais le plus important, à mon avis, est de créer des personnages de femmes qui se battent. De préférence, des protagonistes mais pas seulement. Nous devons inspirer les filles, leur montrer qu’elles peuvent y arriver autant que les garçons. Je pense, en plus, que le sexe d’un protagoniste n’a aucune incidence sur l’identification. Personnellement, je vibre pour Mulan, pour Qiu Ju (Gong Li) dans Qiu Ju, une femme chinoise, pour les cinq sœurs de Mustang, pour Annie Sullivan dans Miracle en Alabama… Je ne vois même pas que ce sont des femmes. Je ne me dis pas : « Tiens, Yves, t’es en train de t’identifier à une femme ! ». L’identification est émotionnelle, pas intellectuelle. Je peux m’identifier à un robot quand je regarde WALL-E. Je me fiche du sexe du protagoniste même si ce serait bien que les femmes soient plus représentées, qu’elles ne soient pas uniquement des prostituées ou des anges, qu’il y ait de tout, des ingénieures, des avocates, des chirurgiennes. Ce serait bien pour la grandeur de l’humanité. Sur les personnages féminins, je me permets quelques suggestions dans Construire un récit. Je parle entre autres du test de Bechdel-Wallace. Et je suis d’autant plus à l’aise pour en parler que le seul long métrage que j’ai écrit et réalisé jusqu’à maintenant a pour protagoniste une jeune femme (Émilie Dequenne). Dans l’histoire que je viens de signer avec Albin Michel, en vue de réaliser une bande dessinée, la protagoniste est une femme de 45 ans. Je ne choisis pas une femme comme protagoniste par air du temps, par opportunisme ou par complaisance. Dans Oui, mais… il était logique que ce fût une jeune fille parce qu’il y a une histoire de découverte de la sexualité et il me semblait que pour une adolescente, c’est encore plus délicat que pour un adolescent. Dans le projet de bande dessinée, il est également logique que la protagoniste soit une femme. Et en plus je travaille avec une dessinatrice, Carole Maurel !

En 2020, il y a encore des hôtesses au salon de l’auto ou au Tour de France…
Ce sont les restes d’une autre époque. On ne se rendait pas compte, on était pourris inconsciemment par le patriarcat. Vous aimez Louis De Funès, revoyez Hibernatus. Dans ce film de 1969, Xavier Gélin joue le fils de la maison qui, à un moment, se met à draguer une servante (Martine Kelly) de façon abusive. Il la force. Je ne compte plus le nombre de films français, américains, italiens, espagnols, etc., jusqu’aux années 80, ou encore le nombre de westerns où on voit une femme qui n’a pas envie et que le protagoniste force à l’embrasser.
Cela peut être classé comme du harcèlement aujourd’hui.
C’est du harcèlement. Et le pire, c’est qu’elle finit par trouver ça bien.
Alors que « Non, c’est non ».
Exactement. C’est culturel. Ce qui est formidable c’est qu’on est en train d’ouvrir les yeux. #MeToo et d’autres mouvements sont en train d’ouvrir les yeux de la planète sur des pratiques inadmissibles. On parlait tout à l’heure de pan-pan, vroum-vroum, boum-boum comme quelque chose de culturel et donc d’inconscient. Il y a plein de cinéastes qui mettent du sexisme, ou du racisme, de l’homophobie, de l’antisémitisme dans leurs histoires sans s’en rendre compte. Il existe un cinéaste français assez célèbre qui est pour moi misogyne, tous ses films sont misogynes. Dans les années 70 et 80, il y a plein de films français de toute sorte où on trouve des fantasmes pédophiles, ça se sent. Il y a un film en particulier, qui est beaucoup apprécié par tout le monde sauf par une poignée dont je fais partie, c’est un film que je déteste pour un tas de raisons. A un moment, on voit une gamine de douze ans dont les seins sont au tout début de formation, qui prend un bain à moitié à poil. Qu’on m’explique ce qu’elle fiche là ! Rien ne justifie qu’on la voit comme ça. Pour moi c’est un petit plaisir coupable. Ce n’est pas le seul du film, malheureusemment. Le pire est atteint dans Les chiens de paille, qui date de 1971. Une femme (Susan George) est violée. Au début, elle résiste, dégoûtée et terrifiée, comme toute femme qu’on force à une relation sexuelle. Et puis, à la fin, elle se radoucit et va même jusqu’à embrasser son violeur. Comme si, finalement, ce n’était pas si désagréable que cela. Cette scène d’une misogynie inouïe est abjecte et, même, pousse-au-crime.
Que pensez-vous de l’affaire Polanski ?
Oh là ! J’en pense beaucoup de choses. En premier lieu, il faut dire que ce qu’a fait Polanski en 1977 à Samantha Geimer est une ignominie. Un viol. Un crime. Pour les autres accusations, je ne me prononce pas car il ne les a pas reconnues et que je suis un fervent défenseur de la présomption d’innocence. C’est un élément capital de notre état de droit. Je ne dis pas que Polanski est innocent, je rappelle juste qu’il est présumé innocent. Ce n’est pas exactement la même chose. J’ai une intime conviction mais je ne suis pas juge. Et je vomis les tribunaux populaires des réseaux sociaux. Ensuite, je pense que réduire Polanski à un violeur, c’est infantile. Roman Polanski est aussi un père, un mari, le veuf de Sharon Tate, un acteur, un cinéaste, l’enfant d’une famille en partie décimée dans les camps d’extermination, etc., etc. Polanski est tout cela. C’est pourquoi, de la même façon, réduire Polanski à un génie du cinéma est infantile. Polanski est aussi un citoyen, avec les mêmes droits et devoirs que tout le monde. S’il enfreint une loi, il doit en payer le prix, indépendamment de son statut social. Je pense également qu’il y a une différence de taille entre Polanski et quelqu’un comme Gabriel Matzneff. Car ce dernier fait de la littérature avec ses crimes, il en fait même l’apologie. Polanski n’a jamais réalisé un film qui fasse l’apologie du viol ou de la pédocriminalité. C’est pourquoi j’estime qu’il a le droit de faire les films qu’il fait, de même que quiconque a le droit de ne pas aller les voir. Polanski a néanmoins commis une maladresse, pour ne pas dire une énorme connerie, à la Mostra de Venise 2019. Dans le dossier de presse de J’accuse, il disait qu’il s’identifiait à Dreyfuss (qui, en plus, n’est pas le protagoniste du film) car il sait ce que c’est que d’être accusé à tort. Franchement pas malin. Si j’étais Polanski, je raserais les murs sur ces sujets. Résultat, quelques semaines plus tard, Valentine Monnier s’est exprimée et le dossier de presse a été amendé. Une autre maladresse, commise celle-là par l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma Français, était de proposer Polanski au poste de président d’honneur des Césars en 2017. C’est une chose de reconnaître à Polanski le droit de faire du cinéma, c’en est une autre de le mettre en lumière, au mépris des femmes qui ont eu le courage de s’exprimer et qui ont été entendues par une partie de la population.
Comment fait-on pour écrire un mauvais scénario ?
Ah, la question qui tue ! Certains aimeraient que je vous réponde : en s’efforçant de respecter scrupuleusement les règles. Non, mieux : en s’efforçant d’appliquer des recettes. Car, comme chacun sait, les règles sont tellement liberticides qu’on est en droit de les qualifier de recettes. Plus sérieusement, je pense qu’un bon moyen d’écrire un mauvais scénario consiste à laisser son génie créatif vagabonder et à placer coûte que coûte toutes les scènes, les images, les dialogues sublimes (forcément sublimes) qui vous ont traversé la tête et qui vous font plaisir. Un autre moyen majeur d’écrire un mauvais scénario consiste à ne pas le faire lire ou/et à ne pas écouter les autres. Il y a plus de deux mille ans, Horace suggérait déjà aux poètes dramatiques de se trouver des analystes du talent d’Aristarque de Samothrace. En d’autres termes, de bons script doctors. Un autre moyen est d’abandonner trop vite devant la difficulté. Comme cet individu qui cherche de l’eau dans le désert, creuse un puits de 3 mètres, ne trouve pas d’eau, et décide d’aller creuser ailleurs d’autres puits de 3 mètres. Vous me direz que certains creusent des puits de 40 mètres et ne trouvent pas d’eau pour autant. C’est vrai. C’est d’ailleurs un autre moyen d’écrire un mauvais scénario : être incompétent. Mais c’est tellement dur de le comprendre. On n’est pas dans une science exacte et nous n’avons aucun recul sur nos compétences réelles.
Il y a encore d’autres façons d’écrire un mauvais scénario : 1- vouloir tout y mettre, par exemple tous les thèmes qui vous touchent, comme si vous alliez mourir demain. Ou comme si vous n’aviez droit qu’à une seule cartouche, qu’un seul film dans votre vie. Or qui trop embrasse mal étreint. Simplicité et unité d’action sont des valeurs cardinales ; 2- vouloir faire du Francis Veber ou du Abbas Kiarostami ou du Frères Coen. Tous les artistes du monde ont commencé par admirer leurs aînés et, parfois même, par copier leurs aînés. Mais on ne devient artiste que quand on « tue le père », quand on s’affranchit de ses influences pour créer quelque chose de personnel ; 3- déconstruire à tout prix, pour faire le malin. Mettre la fin au début et le milieu à la fin peut avoir du sens (dans Memento, par exemple) mais souvent, je sens plutôt le manque de confiance dans un récit simple et présenté dans l’ordre ; 4- mettre en scène un fantasme personnel. Qu’il soit sexuel, d’harmonie ou de toute-puissance. Très souvent, le conflit et la structure font les frais de cette démarche.
Comment expliquer, malgré l’existence des lecteurs professionnels, des script doctors et autres commissions, que certains films soient des navets et trouvent le chemin des salles, des chaînes télé ou du streaming ?
Je pense que l’évaluation du scénario pêche gravement en France. Quand vous lisez un scénario, et plus généralement quand vous recevez une œuvre d’art, vous utilisez deux grilles qui se superposent imperceptiblement, une subjective et une objective. Ainsi, vous pouvez être séduit par un projet parce qu’il vous touche personnellement alors qu’il est mal exploité, mal structuré, mal traité. Et puis il y a un mythe dans le cinéma français : l’idée que la mise en scène peut sauver un récit maladroit. Résultat, si un beau sujet est mal écrit mais que le réalisateur est sympathique, certains se diront quand même que ça vaut le coup de tenter l’aventure.
A part Francis Veber je suis incapable de citer le nom d’un scénariste français vivant. Pourtant je me croyais cultivé. En revanche, je suis capable de citer un nombre incroyable de réalisateurs…
Je suis sûr qu’il y a quelques semaines, vous m’auriez cité Jean-Claude Carrière. Il y a quelques mois, Jean-Loup Dabadie. Mais Frédéric Krivine, ça ne vous dit rien ? Votre ignorance peut être due à un manque d’intérêt. Mais aussi et surtout au fait que les médias ne font pas leur boulot correctement depuis des décennies. Les journalistes ne parlent que des comédiens et des réalisateurs. Comme, en plus, en France, la plupart des réalisateurs sont aussi co-scénaristes des films qu’ils réalisent, les journalistes doivent se dire qu’il est inutile de citer les autres auteurs. Ce qui les amène souvent à proférer des énormités. Quand ils sentent de façon diffuse une faiblesse dans le scénario, ils incriminent la mise en scène. Je pense à ce critique de Une chance sur deux qui écrivait en 1998 : « Comment se fait-il que l’auteur de Ridicule ait pu pondre un film aussi mauvais que Une chance sur deux ? ». Si ce monsieur était professionnel et connaissait les différents artisanats du cinéma, il saurait que le principal auteur de Ridicule se nomme Rémy Waterhouse et non Patrice Leconte, qui est en revanche le principal auteur de Un homme sur deux. Je précise pour ceux qui voudraient déformer ma pensée que j’ai bien dit « principal auteur », pas « seul auteur ».
Quand John Schlesinger est décédé en 2003, Ouest France a titré : « Le père de Macadam Cowboy est mort ». Est-ce que Ouest France a jamais su que Macadam Cowboy avait également une mère, nommée Waldo Salt, et même une grand-mère, nommée James Leo Herlihy ? Quand vous attribuez à un réalisateur l’intégralité du sens véhiculé par un film qu’il n’a pas écrit, vous faites preuve de paresse intellectuelle et vous étalez votre incompétence au grand jour.
Yves, je plaisantais. Grâce à vous notamment, je connais le nom de beaucoup d’entre eux. L’invisibilisation des scénaristes est donc un fait. Vous pensez comme la scénariste Sabrina B. Karine que le réalisateur empiète sur le territoire du scénariste parce que – en France – il n’a pas lui-même un espace d’expression suffisant ?
Aux Etats-Unis, aussi, les réalisateurs empiètent sur le territoire des scénaristes. Il paraît que Robert Riskin a envoyé un jour cent pages blanches à Frank Capra en lui disant : « Tiens, exerce ta fameuse Capra touch là-dessus ». N’oubliez pas la force des egos. Dans un livre de 1972 (The screenwriter looks at the screenwriter), le scénariste et producteur William Froug écrit : « Dans le monde du cinéma, d’Hollywood à Rome, de Paris à Tokyo, de Londres à Prague, s’il n’y a pas de scénariste, personne ne travaille. Est-ce donc si étonnant qu’on en veuille, consciemment ou inconsciemment, aux auteurs ? Est-ce si surprenant que tous les egos liés à la fabrication d’un film – et la taille de ces egos-là est gargantuesque – se sentent froissés par cette vérité essentielle qu’ils sont tous démunis et même inemployables tant que le scénariste n’a pas écrit un scénario ? ». Caroline Bongrand, l’autrice principale du film Eiffel, raconte que Luc Besson était intéressé à réaliser son scénario mais voulait le signer. Elle lui a dit d’accord, mettons nos deux noms sur le scénario. Besson lui aurait répondu qu’il voulait être le seul à le signer ! C’est de l’abus pur et simple. Les scénaristes sont victimes de violences de ce type depuis à peu près 1920.
L’actualité des scénaristes français, cet hiver 2020/21, c’est « Paroles de scénaristes » sur Facebook. C’est un peu le #metoo des scénaristes, isn’t it ?
Exactement. Les témoignages sont terribles. La maltraitance du scénario et des scénaristes est abyssale. Une expérience professionnelle récente m’a fait comprendre que l’une des causes de cette maltraitance est circonstancielle. Le scénario est le seul poste d’une œuvre audiovisuelle qui est créé avant qu’on ait de l’argent. Les activités d’une comédienne, d’une scripte, d’un chef-opérateur interviennent quand le producteur a réuni son budget. Ces activités peuvent être financées correctement. Mais quand vous financez une écriture, vous n’avez aucune garantie que le film se fera. Même si l’auteur vous pond un scénario formidable, vous pouvez échouer à trouver le budget. Dans ces conditions, vous avez tendance à minimiser les risques et donc à sous-financer l’écriture. Je ne parle même pas des auteurs qui écrivent de façon « spéculative », dans leur coin, en espérant pouvoir vendre leur scénario un jour. Eux ne sont pas payés du tout. Et quand ils arrivent à vendre leur scénario, devinez ce qu’il se passe. Beaucoup de producteurs vont acheter le scénario trois cacahuètes (en plus avec l’argent des autres !). Primo, parce qu’ils ne comprennent pas la somme de temps, d’énergie et de compétence qu’un récit représente. Secundo, parce qu’ils n’ont pas vu l’auteur travailler, alors qu’ils voient les comédiens, les techniciens, le monteur travailler. Le labeur des scénaristes est invisible. Tertio, parce qu’ils préfèrent mettre de l’argent dans ce qu’il reste à faire plutôt que dans ce qui existe déjà. Résultat des courses, d’après une étude du CNC sur les coûts de production des films français en 2019, le poste scénario représente en moyenne 3 % du budget des films. 3 % pour le poste le plus important d’un film, pour l’œuvre qui donne du boulot à 150 personnes, c’est honteux ! Honteux et stupide. Les décideurs devraient se méfier des auteurs qui acceptent d’être payés des cacahuètes. Souvent, ils travaillent comme des singes.
« Historiquement, le premier conteur était le prêtre. Il nous expliquait les saisons, les astres, la germination, à coup de mythes et de croyances magiques. Et puis, petit à petit, la science a rendu les humains moins crédules. Le théâtre et la littérature sont devenus laïques. »
Vous ne semblez pas croire à l’existence du libre arbitre. Or beaucoup de fictions mettent en scène la responsabilité morale individuelle, la capacité de l’humain à choisir une voie plutôt qu’une autre.
C’est exact. C’est même devenu une obsession dans le cinéma américain et dans les séries. Les mots « choix » et « choisir » sont omniprésents. Les moments de choix, ces scènes où l’un des personnages, souvent le protagoniste, est poussé à prendre une décision capitale pour lui ou pour l’action, peuvent être des moments forts du récit. D’ailleurs, ils coïncident parfois avec le climax ou avec ce que j’appelle le « climax trajectoriel ». Que la fiction nous enseigne que nous avons la responsabilité de nos actes, pas de problème. J’approuve à 100 %. Que la fiction nous rappelle que nous sommes parfois confrontés à des dilemmes cruels, formidable. Mais que la fiction aille jusqu’à nous faire croire que nous sommes totalement libres, que nous ne dépendons pas de notre éducation et de nos névroses, et donc de facteurs indépendants de notre volonté, là, je suis sceptique. Permettez-moi de vous rappeler que les êtres humains sont privés des choix majeurs de l’existence. Nous ne choisissons pas de naître, d’autres choisissent pour nous. Nous ne choisissons pas de naître dans une famille équilibrée, défaillante ou toxique. Nous ne choisissons pas notre sexe ou la couleur de notre peau ou notre orientation sexuelle. Nous ne choisissons pas d’être mortels ou immortels. Nous ne choisissons pas le moment de notre mort ni de quelle façon nous allons mourir (sauf dans les cas de suicide). Excusez du peu ! Je suis désolé d’être déprimant mais ce sont des faits. Je pense d’ailleurs que la conscience qu’a l’humain de sa mortalité est à l’origine de beaucoup d’anxiété, personnelle et collective. C’est ainsi que je m’explique l’invention des religions qui, vous l’aurez remarqué, proposent toutes une vie après la mort. Comme une consolation. C’est l’un des propos de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, qui est si souvent citée dans les enterrements. Je ne dis pas qu’il ne nous reste plus aucun choix. Je dis que les choix fondamentaux de l’existence nous sont soustraits et que nous ne contrôlons pas entièrement ceux qui restent. Alors il est possible que les auteurs essaient eux aussi de consoler les humains avec des fictions qui magnifient le libre arbitre. Et puis, si au lieu de parler de « choix », nous parlions de « contrôle ». Ou même de « domination ». La vie est tellement imprévisible, nous glisse tellement entre les doigts que nous ressentons le besoin de croire à la possibilité de son contrôle. C’est ainsi que nous cherchons du sens partout. Dans les entrailles de poulet, les lignes de la main, l’alignement des astres… Mais aussi dans les récits. Il y a quelque chose qui m’amuse sur ce sujet du libre arbitre. Certains auteurs veulent nous faire croire que leurs personnages ont le choix alors qu’en réalité, si on réfléchit bien, lesdits personnages sont soumis au bon vouloir démiurgique de leur auteur. J’imagine bien Kane (Gary Cooper) dire à Carl Foreman (le scénariste du Train sifflera trois fois) qu’il n’a pas envie de rester à Hadleyville pour attendre le méchant, qu’il préfère partir en voyage de noces. Et Carl Foreman lui répond que s’il fait cela, il n’y aura pas de film. Donc, Kane n’a pas le choix, il doit rester et affronter Miller. Idem avec Jack Bauer (Kiefer Sutherland) dans 24 heures chrono : Rédemption. A la fin du téléfilm, Jack vit un gros moment de choix : sauver des enfants contre sa liberté ou rester libre contre la sécurité des enfants. Quel choix fait Mister Jack Bauer, à votre avis ? Un autre choix qui n’en est pas un, c’est le célèbre choix de Sophie, en référence au roman de William Styron. Sophie arrive dans un camp d’extermination avec ses deux enfants et un nazi lui demande de choisir lequel de ses enfants va être gazé tout de suite et lequel va survivre (à court terme). Vous parlez d’un choix ! C’est juste de la torture. C’est comme si je vous disais que je vais vous arracher un testicule sans anesthésie et que vous avez le choix entre le gauche ou le droit. Où est le libre arbitre dans tout cela ? Pour finir sur une note plus légère, je vous raconte un gag génial d’Emmanuel Reuzé dans le premier tome de Faut pas prendre les cons pour des gens. Une cancérologue annonce à un milliardaire qu’il n’a plus que quelques mois à vivre. Le milliardaire propose alors une grosse somme d’argent pour s’en sortir. La cancérologue lui explique que l’argent ne peut pas tout acheter et que le milliardaire doit se résoudre à accepter l’issue fatale. Mais le milliardaire insiste, il négocie, augmente le montant de son offre. La dernière case montre une tombe sur laquelle est inscrit : « Forte récompense à qui me sortira de là. »
Bravo d’avoir plombé l’ambiance, Yves. Jusque là, mes lecteurs et moi-même essayions de trouver dans les films et les séries un peu de sens et de réconfort à l’existence, et vous là, d’un coup, vous avez tout niqué, excusez mon anglais.
Je vous signale que l’ambiance est déjà plombée depuis bien longtemps. Les humains ne m’ont pas attendu pour le sentir, ne serait-ce qu’inconsciemment. La question est de savoir ce que nous faisons de notre condition humaine et de nos limites. Cherchons-nous le réconfort dans la religion, les croyances irrationnelles, les compétitions sportives, les crèmes anti-rides, le clonage, la cryogénisation, l’argent, la science, l’amour, les récits ?… Le réconfort dans la science, l’amour et l’art me paraît être un beau programme. Mais que demander aux récits ? De nous égarer, de nous entretenir dans l’illusion ? Est-ce le meilleur moyen de nous aider à vivre et à grandir ? J’aime les récits qui donnent de l’espoir plutôt que de l’illusion, les récits qui disent la vérité sur la vie et la nature humaine, au risque parfois de plomber un peu l’ambiance.
Si le choix est le thème qui revient le plus dans la culture cinématographique américaine, quel thème se dégage de la cinématographie française ?
Aucune idée. Mais comme je trouve les Américains trop obsédés par la spiritualité, au point d’en devenir mystiques, je chercherais du côté de la laïcité et de la temporalité. Historiquement, le premier conteur était le prêtre. Il nous expliquait les saisons, les astres, la germination, à coup de mythes et de croyances magiques. Et puis, petit à petit, la science a rendu les humains moins crédules. Le théâtre et la littérature sont devenus laïques. Œdipe roi est une œuvre charnière dans cette optique. Certains prétendent qu’Œdipe y est victime des dieux et du destin. Mais il est aussi victime de son sale caractère. Il y a de la psychologie dans la pièce de Sophocle. Ensuite Galilée, Darwin et Freud ont porté un coup fatal à nos fantasmes de grandeur. En gros, Galilée a démontré que la Terre n’était pas le centre de l’univers. Darwin a démontré que nous ne descendons pas d’Adam et Eve. Et Freud a démontré que nous sommes le fruit d’agents indépendants de notre volonté. Ces trois pourfendeurs de la vanité humaine nous ont remis à notre place, notre petite place. Savez-vous quelle est l’une des grandes solutions à notre angoisse existentielle ? Le chocolat ? Les sex toys ?… Eh bien non, figurez-vous que c’est la comédie. Car elle a une dimension philosophique, elle porte un message de vérité et de lâcher prise. « Laisse tomber, tu es limité et ridicule. C’est la vie. » Dans son article intitulé L’humour, Sigmund Freud explique que l’attitude humoristique a l’immense avantage de ne pas nous faire quitter le terrain de la santé psychique, contrairement a d’autres moyens de défense contre la douleur comme la névrose, la folie, l’ivresse, l’extase ou le repliement sur soi. Comme l’a, paraît-il, dit Ricky Gervais : « Vous trouvez ça vexant ? Moi je trouve ça drôle. C’est pour cela que je suis plus heureux que vous. »
Vous dites du cinéma français qu’il a « une faiblesse narrative »…
C’est une généralité. Il y a des exceptions. Mais je le constate, comme tout le monde. Je n’en connais pas la cause exacte. Probablement les réflexions de certains critiques d’art (Elie Faure, Germaine Dulac, Ricciotto Canudo…) dans les années 20. Peut-être aussi l’influence du Nouveau Roman. En 2006, c’est-à-dire il n’y a pas si longtemps, j’ai entendu un critique me dire : « Le scénario n’est qu’un prétexte. » En 2006, en France, on en est encore là ! Combien de fois ai-je lu que le scénario n’est qu’un objet transitoire destiné à finir dans une poubelle. Même le regretté Jean-Claude Carrière le disait. Or c’est vrai du scénario au sens d’outil technique. Ou de plan du film en devenir. Mais c’est faux, archi faux, du récit qui se trouve dans le scénario, quand il y en a un. Ce scénario-là, le scénario-récit, se retrouve dans le film (et non dans une poubelle), comme « un cœur qui bat », pour reprendre la jolie expression de Nicole Garcia aux Césars 2000.
Vous parlez d’intimidation culturelle voire de “terrorisme culturel”. Pouvez-vous expliquer ces notions à des gens qui ne vous ont pas lu ? Qui organise ce terrorisme ?
Nous avons affaire à une idéologie. Elle n’est pas politique ou religieuse mais c’est quand même une idéologie. Or toutes les idéologies dans l’histoire de l’humanité ont au moins deux caractéristiques communes : 1- elles nient une partie du réel et 2- elles font du prosélytisme. Ce qui est assez logique. Quand vous créez une carte idéalisée avant d’observer le territoire avec rigueur, vous êtes rapidement confronté à des faits têtus. Le réel vous remet en cause et le manque de confiance n’est pas loin. C’est inconscient mais ça vous ronge. Alors, vous faites comme les alcooliques qui n’ont pas envie de boire tout seuls et qui remplissent le verre de leurs voisins. Cela vous rassure que les autres pensent comme vous. Ce prosélytisme peut être agressif. Dans le cas des idéologies politiques ou religieuses, il est même souvent violent. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’autre, vous avez droit à la guillotine, à l’extermination, au lavage de cerveau, au camp de rééducation, etc. Parfois, je me prends à rêver que les idéologues violents ne soient pas stoppés et arrivent au bout de leur logique. Car ils finissent souvent par ne pas être d’accord avec leurs plus proches camarades de combat. Après avoir fait assassiner tous les Danton et les Trotski, les Fouquier-Tinville et les Staline se retrouveraient seuls au monde, comme des cons, et découvriraient qu’ils ne sont peut-être même pas d’accord avec eux-mêmes !
Je sais ce que vous allez me dire. Et si ma conception du scénario et de l’art du récit était, elle aussi, une idéologie ? Et si mon prosélytisme n’était pas la preuve que je ne suis pas sûr de mon coup ? Vous avez peut-être raison. La troisième caractéristique commune à toutes les idéologies est d’aveugler leurs propriétaires. Donc, peut-être que je suis aussi un idéologue et que je ne m’en rends pas compte. C’est aux autres de m’éclairer. Mais avec des preuves scientifiques, s’il vous plaît. Quelques remarques, néanmoins. D’abord, je ne suis pas sûr d’être prosélyte. Je n’ai pas écrit mes livres pour convaincre le microcosme, je les ai écrits pour mettre mes idées au clair et me constituer une méthode. Notez que je n’ai compris cette motivation profonde qu’assez récemment. J’ai découvert, récemment aussi, que Marc Herpoux avait suivi la même démarche pour monter son séminaire sur le genre. A l’origine, il a constitué ses réflexions pour lui, en tant qu’auteur, pas pour qu’elles soient transmises. Ensuite, ce n’est pas parce que l’Airbus A320 est un avion que tous les avions sont des Airbus A320. En d’autres termes, ce n’est pas parce que les idéologues sont toujours prosélytes que tous les prosélytes sont forcément idéologues. Si j’essaie de vous convaincre que la Terre est sphérique et tourne autour du Soleil, je ne suis pas idéologue. Si j’affirme que la vaccination a permis de sauver des millions de vies humaines de la rougeole, du tétanos ou de la variole, je ne suis pas idéologue. Troisièmement, on est en droit de se battre contre les idéologies quand on constate qu’elles font des dégâts. On ne peut malheureusement pas compter uniquement sur les assassinats de tous les Danton et tous les Trotski.
Dans un livre de 2006, un défenseur acharné (et, à mon avis, maladroit et malhonnête) de la politique des auteurs affirme que les remakes des films réalisés par Sacha Guitry ont été des échecs critiques et commerciaux. Ce serait donc la preuve que le cinéma d’auteur est supérieur. D’abord, depuis quand un succès public est la preuve de la qualité artistique d’une œuvre ? Ensuite, c’est faux. Objectivement faux. Certains remakes se sont plantés, en effet, mais pas tous. Si vous consultez les chiffres officiels, La poison, l’un des meilleurs scénarios de Guitry, a fait 1,8 millions d’entrées France en 1951 et son remake Un crime au paradis en a fait 2,1 millions en 2001. Quant au succès critique d’une œuvre comme preuve de sa qualité, permettez-moi d’être un tantinet dubitatif. Dans Évaluer un scénario, je cite un commentaire critique d’époque sur Le pigeon (1958), qui vaut son pesant de cacahuètes. Sur La poison, justement, les Cahiers du Cinéma écrivaient (dans leur numéro 8 de janvier 1952) : « La réalisation est d’une grande platitude, d’une médiocrité soutenue et d’une mélancolique pauvreté. L’interprétation – Michel Simon mis à part – est très ordinaire. Les « mots » même du « maître » ne sont pas très drôles. Mais la simple vertu d’un scénario relativement original et audacieux fait que ce film attire plus l’attention que nombre de grandes productions françaises. » Sic ! Même si je suis ravi que les Cahiers du Cinéma aient conscience que le scénario (au sens de récit) joue un rôle, vous voyez que le succès critique de La poison n’est pas éclatant. Enfin bref, je crois qu’on peut dénoncer les excès et les dégâts d’une idéologie sans être idéologue.
A part la politique des auteurs, il existe un autre « terrorisme culturel », commun à tous les arts, qui consiste à porter aux nues des œuvres fragiles, souvent impopulaires, et à traiter de méprisables incultes ceux qui n’y sont pas sensibles. J’ai été cinéphile très tôt. Je me souviens même de la date. C’était à l’automne 1972, j’avais 13 ans et demi, j’étais en Troisième dans un pensionnat. Chaque lundi, nous échangions sur les films que nous avions vus pendant le week-end. Un jour, l’un de mes camarades, un type très mûr pour son âge, très cultivé, a dit à propos des autres membres de la bande : « Ils parlent des films, de leurs sujets, de leurs acteurs principaux, mais sont incapables de citer le nom de leur réalisateur ! ». Tilt ! J’ai commencé à m’intéresser aux réalisateurs. J’ai acheté les revues de cinéma de l’époque : Positif, Les Cahiers du Cinéma, Écran, Cinématographe, La Revue du Cinéma-Image et Son… Et le malaise a commencé. Des spécialistes me vantaient les mérites de films qui m’emballaient mais aussi d’un paquet de films qui m’ennuyaient prodigieusement. On me disait que Hitchcock était un génie, dont tous les films étaient des chefs d’œuvre. Alors j’allais voir Psychose, La mort aux trousses ou Fenêtre sur cour. Et j’étais d’accord. Puis j’allais voir L’étau, Vertigo ou Les amants du Capricorne et j’étais consterné. J’ai mis quelques années à comprendre que beaucoup de critiques n’étaient pas authentiques, qu’ils commentaient en fonction de préjugés, d’attentes, de postures, et non en fonction de leur ressenti sincère. Qu’ils vomissaient le succès commercial, qu’ils avaient de la complaisance vis-à-vis des œuvres dites « difficiles » ou « fragiles ». Pour moi, ce qui rend un film fragile, ce n’est pas un thème délicat ou un budget étriqué, c’est la médiocrité de son artisanat, en particulier de sa narration. En 1962, Truffaut a expliqué à Hitchcock que les critiques, ses anciens collègues, ont tendance à encenser les films qu’ils se sentiraient capables de faire eux-mêmes. Pas très flatteur ! A moins que les films ne soient que des prétextes pour permettre au critique de parler… de lui-même. Je me suis aussi rapidement rendu compte que je me contrefichais de l’avis de Dupont ou Durand sur un film et que je cherchais des outils pour faire des films moi-même. C’est pourquoi j’ai béni certains critiques comme Raymond Bellour, François Chevassu ou Jean-François Tarnowski. Ils étaient très faibles sur la question du scénario mais, au moins, ils m’initiaient au langage filmique. Malheureusement, c’était des exceptions. Je parle là d’une époque que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Dans les années 70, les réseaux sociaux n’existaient pas, il n’y avait pas d’avis du public sur les sites internet. Les critiques avaient plus de pouvoir. Du moins le croyait-on. Jusqu’en novembre 1982, date de la fameuse bataille L’as des as – Une chambre en ville, où on a vu que l’empereur était nu. Pour mémoire, le 27 octobre 1982, jour de sortie des deux films, la critique fut aussi unanime à descendre celui réalisé par Gérard Oury qu’à encenser celui réalisé par Jacques Demy. Devant les premiers résultats, excellents pour L’as des as, catastrophiques pour Une chambre en ville, la critique en remit une couche la semaine suivante, accusant bêtement un film de voler des spectateurs à l’autre et insistant lourdement pour que les cinéphiles fissent le « bon choix ». En vain. La critique n’a même pas réussi à convaincre son propre lectorat. L’as des as totalisa 5 450 000 entrées et Une chambre en ville 231 000. C’est à peu près à partir de cette époque qu’une partie de la critique française s’est mise à cultiver le clash, insulter les comédiens, pondre des jeux de mots agressifs, dévoiler les coups de théâtre de fin, etc… Une sorte de baroud d’honneur indigne.
« Mon but est de permettre aux auteurs d’écrire autant La cerisaie que Terminator, en d’autres termes d’écrire du eux-mêmes. »
La youtubeuse Sweetberry raconte que la lecture de L’anatomie du scénario de John Truby l’a paralysée pendant trois ans et que c’est la lecture de La Dramaturgie qui l’a débloquée. Alors que personnellement, c’est Construire un récit qui a été source de blocages. Vous me conseillez de lire Truby pour me débloquer ou de faire tout simplement abstraction des règles ?
Avant de vous conseiller quoi que ce soit, je voudrais d’abord vous présenter mes plus plates excuses. Je n’ai pas écrit La Dramaturgie ou Construire un récit pour provoquer des blocages. Je sais que la méthode proposée dans Construire un récit rend service à certains, leur donne même de l’énergie pour écrire, mais qu’elle ne convient pas à tout le monde. Qu’elle ne vous rende pas service est une chose, qu’elle aille jusqu’à vous bloquer me désole sincèrement. Quand j’ai commencé à lire des traités de narration au début des années 80, j’ai cherché des outils pour ma pratique personnelle. J’ai été déçu par Syd Field, que j’ai trouvé très rigide. En revanche, la lecture d’Edward Mabley a été une révélation. J’ai d’ailleurs repris l’esprit de Mabley dans La Dramaturgie et j’ai essayé de proposer un paradigme logique et souple dans Construire un récit. Mon but est de permettre aux auteurs d’écrire autant La cerisaie que Terminator, en d’autres termes d’écrire du eux-mêmes. Après, je ne connais pas la cause exacte de votre blocage. Si, par exemple, vous vous rendez compte en me lisant que l’art de la narration est exigeant, j’ai envie de vous dire : bienvenue au club ! Mais cette prise de conscience ne doit pas décourager. Il existe un ingrédient magique dans l’écriture, qui s’appelle la réécriture. Si on accepte le principe que le premier jet (du pitch, des fondations, du scène-à-scène…) ne sera pas bon mais s’améliorera en remettant son ouvrage vingt fois sur le métier, je pense qu’on s’ôte l’esprit d’un poids, d’une exigence, d’un perfectionnisme. Bien raconter une histoire consiste à gravir une montagne. C’est une course de fond, pas un sprint. On peut regarder le sommet et se dire que c’est trop haut. Ou on peut comprendre que le meilleur moyen d’arriver au sommet est de partir du bas et de mettre tranquillement un pied devant l’autre.
Je pense que votre « manuel » est le plus complexe que j’ai lu. En effet, découvrir le niveau d’exigence de l’art du scénario a été source de blocage. Il y a aussi la peur de ne pas être dans les clous définis par les règles. En tout cas, merci pour la consultation, vous me direz combien je vous dois – en fait beaucoup, mais pas financièrement. Quel est le retour le plus marquant qu’on vous ait fait sur La Dramaturgie ?
Eh bien figurez-vous que celui qui m’a le plus touché date de cette année. Je le tiens de Fanny Douarche qui était jusqu’à récemment coordinatrice pédagogique à l’Ecole de la Cité. Elle m’a dit que La Dramaturgie offrait une réconciliation entre deux tendances du cinéma, une tendance américaine attachée à l’artisanat et aux règles, et une tendance européenne qui privilégie l’artistique. Je ne l’avais jamais formulé ainsi mais je trouve cela assez juste et j’en suis ravi. Il est tellement important de s’appuyer sur ces deux jambes quand on écrit : l’artisanal et l’artistique. Le poète et le comptable, dirait Billy Wilder. Il existe un film savoureux sur ce sujet : Coups de feu sur Broadway, écrit par Woody Allen et Douglas McGrath. John Cusack y joue le rôle d’un dramaturge engagé. Il a un message à faire passer au monde et se prend pour un Artiste avec un grand A. Mais sa pièce est prétentieuse et mal écrite. Il va finir par comprendre que pour être un vrai artiste, il ne suffit pas d’avoir quelque chose à dire, il ne suffit pas de faire confiance à son instinct et à son génie inné, il faut aussi transmettre tout cela correctement, il faut maîtriser la technique de son art. En d’autres termes, un artiste doit aussi être un artisan et, qui plus est, un artisan compétent.
Comment vivez-vous la crise sanitaire, en tant que scénariste et consultant en scénario ?
A mon petit niveau, les confinements ont très peu de répercussions sur ma vie professionnelle. Quand j’écris, je suis chez moi. Je travaille en ce moment avec Carole Maurel et Martin Zeller sur ce projet de bande dessinée. Je fais exactement ce que j’aurais fait en temps normal. D’autant que Carole habite à 400 km de chez moi. Donc télétravail pour tous les deux. Idem pour le script doctoring. Les confinements ne m’empêchent pas non plus de faire du sport. D’un point de vue familial, c’est un peu plus embêtant mais ça va. Ce qui me peine considérablement, en revanche, c’est la fermeture des théâtres et des cinémas. Je la trouve cruelle et, surtout, injuste. Primo, les acteurs de la culture font un travail essentiel, il est triste que nos gouvernants n’en aient pas conscience. Mais bon, ce n’est pas nouveau. Les politiques et la culture, ça fait deux (cf. plus haut). Secundo, d’un point de vue scientifique, je ne vois pas comment des spectateurs qui portent un masque, ne parlent pas et sont éloignés les uns des autres pourraient créer des foyers de contamination.
J’adore Brad Dourif, malgré ses choix de carrière aléatoires. Vous l’avez eu comme prof d’art dramatique à Columbia University, ainsi que Milos Forman. Ils sont comment dans la vraie vie ?
Brad Dourif était assez chaleureux. Et son cours était formidable. Il nous faisait jouer, même si nous n’avions pas envie d’être comédiens. L’idée étant de nous faire comprendre l’art de l’acteur de l’intérieur. Milos Forman était plus distant. Et, à mon avis, pas très pédagogue. Autant j’admire le cinéaste (plusieurs des films qu’il a réalisés font partie de mon panthéon), autant je l’ai trouvé faible comme prof. Une confirmation de plus que ce sont deux métiers différents et qu’on peut être bon dans l’un et pas dans l’autre.
Il me faudrait une seconde vie pour jouer aux jeux vidéos et une autre vie pour vous interroger sur la structure des fictions interactives, mais je vais garder ça pour un autre interlocuteur. Je vais vous laisser conclure sur une dernière question : les mécanismes que vous décrivez dans vos livres, le macguffin, la structure fractale, l’ironie dramatique, et ce genre de choses, est-ce que les auteurs sont condamnés à les répéter jusqu’à la fin des temps ?
Oui. Sauf que c’est tout sauf une malédiction. Les règles, qui chiffonnent tant d’artistes, sont nos amies, nos alliées. En outre, elles sont des moyens, pas des buts. Le but, c’est le sens, l’expression personnelle, le regard (car les scénaristes ont un regard, autant que les réalisateurs), le point de vue sur les choses de la vie. Quelle importance qu’il vous faille utiliser telle boîte à outils plutôt qu’une autre ?
Propos recueillis par Rachid Ouadah.
A LIRE AUSSI :
La Dramaturgie : l’art du récit, d’Aristote à Prison Break
Interview d’Yves Lavandier sur la chaîne Philoscience
Commentaires
2 réponses à “Yves Lavandier : « les êtres humains sont privés des choix majeurs de l’existence »”
Bravo pour votre interview, elle est remarquable. Et bravo à Monsieur Lavandier d’exprimer ouvertement ce qu’il ressent. ça fait un bien fou !
Merci !